Ilana Benhaim, 13 ans, en classe de 4e dans la ville de Limeil Brevannes, me demande des photos et des renseignements sur la libération du camp d’Auschwitz, le 27 janvier 1945.
Janvier 1945 : les marches de la mort
En janvier 1945, l’armée rouge approche d’Auschwitz. On commence à entendre le canon. Les nazis décident d’évacuer le camp. Le 18 janvier 1945, les déportés rassemblés par les S.S. sont jetés sur les routes. Commencent alors les terribles marches de la mort : à pied ou dans des wagons à ciel ouvert, les déportés sont transportés vers les camps encore en activité. Ceux qui ne peuvent pas suivre sont abattus.
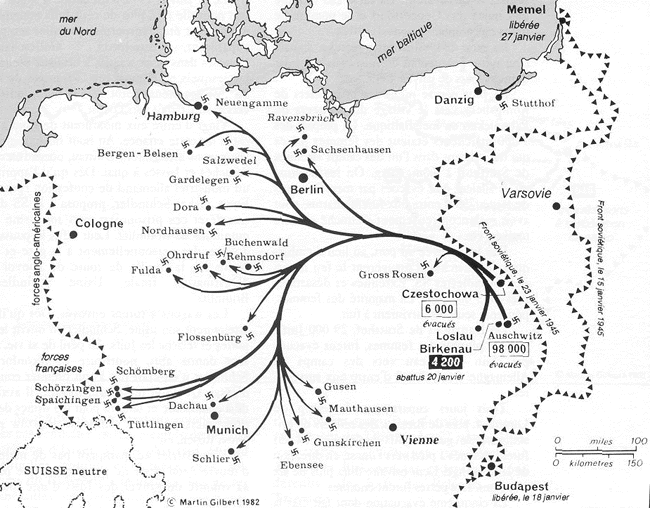
Près de 100.000 déportés sont ainsi jetés sur les routes. Des dizaines de milliers ne survivront pas.
Ceux qui restent dans le camp
A Auschwitz, ne sont restés que les malades et quelques déportés qui ont pu se cacher dans les baraques.
Parmi ceux qui échappent à la Marche de la mort, il y a Primo Levi. Il attrape la scarlatine le 11 janvier 1945 et est hospitalisé au « K.B. Infektionabteilung ». Il y reste quelques jours, fiévreux. Mais les rumeurs circulent.
Dix jours hors du monde et hors du temps
L’annonce de l’évacuation
— Vous ne savez pas ? leur dis-le, demain on évacue le camp.
Ils m’accablèrent de questions :
— Où ça ? A pied ?… Même les malades ? Même ceux qui ne peuvent pas marcher ?
Ils savaient que j’étais un ancien du camp et que je comprenais l’allemand, et ils en concluaient que j’en savais là-dessus beaucoup plus que je ne voulais l’admettre.
Je ne savais rien d’autre; je le leur dis, mais ils n’en continuèrent pas moins à me questionner. Quelle barbe! Mais c’est qu’ils venaient d’arriver au Lager, ils n’avaient pas encore appris qu’au Lager on ne pose pas de questions.
Dans l’après-midi, le médecin grec vint nous rendre visite. Il annonça que même parmi les malades, tous ceux qui étaient en état de marcher recevraient des souliers et des vêtements, et partiraient le lendemain avec les bien-portants pour une marche de vingt kilomètres. Les autres resteraient au K.B., confiés à un personnel d’assistance choisi parmi les malades les moins gravement atteints. […]
Faut-il partir avec les autres ?
[Ce médecin grec] était déjà équipé pour la marche ; dès qu’il fut sorti, les deux jeunes Hongrois se mirent à parler entre eux avec animation. Leur période de convalescence était presque achevée, mais ils étaient encore très faibles. On voyait qu’ils avaient peur de rester avec les malades et qu’ils projetaient de partir avec les autres. Il ne s’agissait pas d’un raisonnement de leur part : moi aussi, probablement, si je ne m’étais pas senti aussi faible, j’aurais obéi à l’instinct grégaire; la terreur est éminemment contagieuse, et l’individu terrorisé cherche avant tout à fuir.[…]
Ils étaient fous de s’imaginer qu’ils allaient pouvoir marcher, ne fût-ce qu’une heure, faibles comme ils étaient, et qui plus est dans la neige, avec ces souliers percés trouvés au dernier moment. J’essayai de le leur faire comprendre, mais ils me regardèrent sans répondre. Ils avaient des yeux de bête traquée.
L’espace d’un court instant, l’idée m’effleura qu’ils pouvaient bien avoir raison. Ils sortirent par la fenêtre avec des gestes embarrassés, et je les vis, paquets informes, s’éloigner dans la nuit d’un pas mal assuré. Ils ne sont pas revenus; j’ai su beaucoup plus tard que, ne pouvant plus suivre, ils avaient été abattus par les S.S. au bout des premières heures de route.
Moi aussi, j’avais besoin d’une paire de chaussures : c’était clair. Mais il me fallut peut-être une heure pour arriver à vaincre la nausée, la fièvre et l’inertie. J’en trouvai une paire dans le couloir (les prisonniers en partance avaient saccagé le dépôt de chaussures du K.B. et avaient pris les meilleures : les plus abîmées, percées et dépareillées traînaient dans tous les coins). […] Je cachai les souliers et retournai au lit.
Le médecin grec refit une apparition tard dans la nuit, coiffé d’un passe-montagne, un sac sur tes épaules. Il lança un roman français sur ma couchette :
— Tiens, lis ça, l’Italien. Tu me le rendras quand on se reverra.
Aujourd’hui encore, je le hais pour ces mots-là. Il savait que nous étions condamnés. […]
Nous restâmes donc sur nos grabats, seuls avec nos maladies et notre apathie plus forte que la peur.
Dans tout le K.B. nous étions peut-être huit cents. Dans notre chambre, nous n’étions plus que onze, installés chacun dans une couchette, sauf Charles et Arthur qui dormaient ensemble. Au moment où la grande machine du Lager s’éteignait définitivement, commençaient pour nous dix jours hors du monde et hors du temps.
Dernière tournée d’un officier S.S.
18 janvier. La nuit de l’évacuation, les cuisines du camp avaient encore fonctionné, et le lendemain matin, à l’infirmerie, on nous distribua la soupe pour la dernière fois. L’installation de chauffage central ne fonctionnait plus ; il y avait encore un reste de chaleur dans les baraques, mais à chaque heure qui passait, la température baissait, et il était clair que nous ne tarderions pas à souffrir du froid. Dehors il devait faire au moins 20° au-dessous de zéro ; la plupart des malades, quand ils avaient quelque chose sur la peau, n’avaient qu’une chemise.
Personne ne savait ce que nous allions devenir. Quelques SS.étaient restés là, quelques miradors étaient encore occupés.
Vers midi, un officier S.S. fit le tour des baraques. Dans chacune d’elles, il nomma un chef de baraque choisi parmi les non-juifs qui étaient restés, et donna l’ordre d’établir immédiatement une liste séparée des malades juifs et non juifs. La situation semblait claire. Personne ne s’étonna de voir les Allemands conserver jusqu’au bout leur amour national pour les classifications, et il n’y eut plus aucun juif pour penser sérieusement qu’il serait encore vivant le lendemain.
Les deux Français n’avaient rien compris et étaient terrorisés. Je leur traduisis de mauvaise grâce les paroles du S.S. ; leur peur m’irritait : ils n’avaient pas un mois de Lager, ils n’avaient pas encore vraiment faim, ils n’étaient même pas juifs, et ils avaient peur.

On eut encore droit à une distribution de pain. Je passai l’après-midi à lire le livre laissé par le médecin : il était très intéressant et j’en garde un souvenir étrangement précis. Je fis également une incursion dans le service voisin, à la recherche de couvertures : de ce côté-là, beaucoup de malades avaient été déclarés guéris et leurs couvertures étaient restées libres. J’en pris quelques-unes assez chaudes.
Quand il sut qu’elles venaient du Service Dysenterie, Arthur fit la grimace : « Y avait point besoin de le dire » ; en effet, elles étaient tachées. Quant à moi, je me disais que de toute façon, vu ce qui nous attendait, il valait mieux dormir au chaud.
La nuit tomba bientôt, mais la lumière électrique continuait à fonctionner. Nous vîmes avec une tranquille épouvante qu’un S.S. armé se tenait au coin de la baraque. Je n’avais pas envie de parler, et je n’avais pas peur, sinon de la manière extérieure et conditionnelle que j’ai dite. Je continuai à lire jusqu’à une heure tardive.
Bombardement du camp
Nous n’avions pas de montres, mais il devait être vingt-trois heures lorsque toutes les lumières s’éteignirent, y compris les projecteurs des miradors. On voyait au loin les faisceaux des éclairages photoélectriques. Une gerbe de lumières crues fleurit dans le ciel et s’y maintint immobile, éclairant violemment le terrain. On entendait le vrombissement des avions.
Puis le bombardement commença. Ce n’était pas nouveau : je descendis de ma couchette, enfilai mes pieds nus dans mes souliers et attendis.
Le bruit semblait venir de; loin, de la ville d’Auschwitz peut-être.
Mais voilà qu’il y eut une explosion toute proche, et avant même que j’aie pu reprendre mes esprits, une seconde et une troisième à crever les tympans. Des vitres volèrent en éclats, la baraque trembla, ma cuillère, logée dans une fente de la cloison en bois, tomba par terre. […]
Quelques minutes plus tard, il fut évident que le camp avait été touché. Deux baraques étaient en flammes, deux autres avaient été pulvérisées; mais c’étaient toutes des baraques vides. On vit arriver des dizaines de malades, nus et misérables, chassés par le feu qui menaçait leurs baraques : ils demandaient à entrer. Impossible de les accueillir.
Ils insistèrent, suppliant et menaçant dans toutes les langues ; il fallut barricader la porte. Ils continuèrent plus loin, éclairés par les flammes, pieds nus dans la neige en fusion.
Plusieurs traînaient derrière eux leurs bandages défaits. Quant à notre baraque, elle semblait hors de danger, à moins que le vent ne tournât.
Les Allemands avaient disparu. Les miradors étaient vides.
Survivre au froid
[…] On ne pouvait pas dormir; un carreau était cassé, et il faisait très froid. Je me disais qu’il nous fallait trouver un poêle, l’installer ici, et nous procurer du charbon, du bois et des vivres. Je savais que tout cela était indispensable, mais que je n’aurais jamais assez d’énergie pour m’en occuper tout seul. J’en parlai avec les deux Français.
19 janvier. Les Français furent d’accord. Nous nous levâmes tous trois à l’aube. Je me sentais malade et sans défense, j’avais froid et j’avais peur.
Les autres malades nous regardèrent avec une curiosité pleine de respect : ne savions-nous donc pas que les malades n’ont pas le droit de sortir du K.B. ? Et si les Allemands n’étaient pas encore tous partis ? Mais ils ne dirent rien, trop contents qu’il y eût quelqu’un pour tenter l’expérience.
Les Français n’avaient aucune idée de la topographie du Lager, mais Charles était courageux et robuste, et Arthur avait du flair et le sens pratique des paysans. Nous sortîmes dans le vent d’une glaciale journée de brouillard, enveloppés tant bien que mal dans des couvertures.
Je n’ai jamais rien vu ou entendu qui puisse approcher du spectacle que nous eûmes alors sous les yeux.
Le Lager venait de mourir, et il montrait déjà les signes de la décomposition. Plus d’eau ni d’électricité : des fenêtres et des portes éventrées battaient au vent, des morceaux de tôles arrachées aux toits grinçaient, et les cendres de l’incendie volaient au loin très haut dans les airs. Les bombes avaient fait leur œuvre, et les hommes aussi : loqueteux, chancelants, squelettiques, les malades encore capables de se déplacer avaient envahi comme une armée de vers le terrain durci par le gel. Ils avaient fouillé dans toutes les baraques vides, à la recherche de nourriture et de bois; ils avaient violé avec une furie haineuse les chambres des Blockälteste grotesquement décorées et interdites la veille encore aux simples Häftlinge ; incapables de maîtriser leurs viscères, ils avaient répandu des excréments partout, salissant la neige précieuse, devenue seule source d’eau pour le camp tout entier.
Attirés par les décombres fumants des baraques incendiées, des groupes de malades restaient collés au sol, pour en pomper un dernier reste de chaleur. D’autres avaient trouvé des pommes de terre quelque part et les faisaient rôtir sur les braises de l’incendie en jetant autour d’eux des regards féroces. Quelques-uns seulement avaient eu la force d’allumer un vrai feu, et faisaient fondre de la neige dans des récipients de fortune.
Nous nous dirigeâmes vers les cuisines le plus rapidement possible, mais les pommes de terre étaient déjà presque épuisées. Nous en remplîmes deux sacs que nous confiâmes à Arthur. Au milieu des ruines du Prominenzblock, Charles et moi découvrîmes finalement ce que nous cherchions : un gros poêle en fonte, muni de tuyaux encore utilisables ; Charles accourut avec une brouette et nous y chargeâmes le poêle ; puis, me laissant le soin de le transporter à la baraque, il courut s’occuper des sacs. […]
Pendant ce temps, me tenant à grand-peine sur mes jambes, je m’efforçais de manœuvrer de mon mieux la lourde brouette. Tout à coup on entendit un bruit de moteur, et je vis un S.S. en motocyclette qui entrait dans le camp. Comme tous mes compagnons, à la vue de leurs visages durs, je fus envahi de terreur et de haine. Il était trop tard pour disparaître, et je ne voulais pas abandonner le poêle. D’après le règlement du Lager, j’étais censé me mettre au garde-à-vous et me découvrir. Je n’avais pas de chapeau et j’étais empêtré dans ma couverture. Je m’écartai de quelques pas de la brouette et fis une espèce de révérence maladroite. L’Allemand passa sans me voir, tourna à l’angle d’une baraque et disparut. Je sus plus tard quel danger j’avais couru. […]
Le camp est désert
20 janvier. L’aube parut : j’étais de service pour allumer le poêle. En plus d’une faiblesse générale, mes articulations douloureuses me rappelaient à chaque instant que ma scarlatine était loin d’être guérie. L’idée de devoir me plonger dans l’air glacial pour aller chercher du feu dans les autres baraques me faisait trembler d’horreur. […]
Il ne nous restait plus que deux jours de vivres (en l’occurrence des pommes de terre); pour l’eau, nous en étions réduits à faire fondre de la neige : l’opération était laborieuse car nous manquions de grands récipients ; on obtenait un liquide trouble et noirâtre, qu’il fallait filtrer.
Le camp était silencieux. Nous croisions d’autres spectres affamés, partis eux aussi en expédition, la barbe longue, les yeux caves, les membres squelettiques et jaunâtres flottant dans des guenilles. D’un pas mal assuré, ils entraient et sortaient, revenant des baraques désertes avec les objets les plus hétéroclites : haches, seaux, louches, clous […].
Aux cuisines, deux de ces créatures se disputaient les quelques dizaines de pommes de terre pourries encore disponibles. […]
L’armée allemande en déroute
De mon lit, je voyais par la fenêtre un bon morceau de route : depuis trois jours déjà la Wehrmacht en fuite y défilait par vagues successives. Blindés, chars « tigres » camouflés en blanc. Allemands à cheval. Allemands à bicyclette. Allemands à pied, avec ou sans armes. Le fracas des chenilles résonnait dans la nuit bien avant l’apparition des tanks.
— Ça roule encore? demandait Charles.
— Ça roule toujours.
Cela semblait ne jamais devoir finir.
21 janvier. Pourtant cela finit. A l’aube du 21, la plaine nous apparut déserte et rigide, blanche à perte de vue sous le vol des corbeaux, mortellement triste. […]
« Ce serait vraiment dommage de se laisser sombrer maintenant »
Moi, je me disais que dehors la vie était belle, qu’elle le serait encore, et que ce serait vraiment dommage de se laisser sombrer maintenant. J’éveillai ceux des malades qui somnolaient, et lorsque je fus certain qu’ils m’écoutaient tous, je leur dis, d’abord en français, puis dans mon meilleur allemand, que nous devions tous désormais ne plus penser qu’à rentrer chez nous, et que nous devions donc, dans la mesure de nos moyens, faire certaines choses, et éviter d’en faire d’autres. […]
Les cadavres s’entassent
22 janvier. Si c’est du courage que d’affronter le cœur léger un danger grave, ce matin-là Charles et moi nous fûmes courageux. Nous étendîmes nos explorations jusqu’au camp des S.S., situé juste de l’autre côté des barbelés électrifiés.
Les gardes du camp avaient dû partir précipitamment. Nous trouvâmes sur les tables des assiettes à demi pleines de potage congelé que nous avalâmes avec une suprême jouissance, des chopes où la bière s’était transformée en glace jaunâtre ; sur un échiquier, une partie interrompue ; dans les chambres, quantité de choses précieuses.
Nous prîmes une bouteille de vodka, différents médicaments, des journaux et revues, et quatre magnifiques couvertures matelassées, dont l’une est encore chez moi à Turin. Joyeux et inconscients, nous rapportâmes ce butin dans notre petite chambre, le confiant aux bons soins d’Arthur. On ne sut que le soir ce qui s’était passé juste une demi-heure après.
Un petit groupe de S.S. probablement isolés mais armés avait pénétré dans le camp abandonné. Ayant trouvé dix-huit français installés dans le réfectoire de la S.S.-Waffe, ils les avaient tous abattus, méthodiquement, d’un coup à la nuque, alignant ensuite les corps convulsés sur la neige du chemin avant de s’en aller. Les dix-huit cadavres restèrent exposés jusqu’à l’arrivée des Russes ; personne n’eut la force de leur donner une sépulture.
D’ailleurs, dans toutes les baraques désormais, certaines couchettes étaient occupées par des cadavres durs comme du bois, que personne ne prenait plus la peine d’enlever. La terre était trop gelée pour qu’on pût y creuser des fosses, de nombreux cadavres furent entassés dans une tranchée, mais dès les premiers jours l’amoncellement débordait du trou, et cet ignoble spectacle était visible de nos fenêtres. […]
De l’autre côté des barbelés
23 janvier. Notre réserve de pommes de terre était épuisée. Depuis plusieurs jours, le bruit courait qu’il y avait non loin du camp, quelque part de l’autre côté des barbelés, un énorme silo de pommes de terre.
Il faut croire que quelque pionnier méconnu avait fait de patientes recherches, ou que quelqu’un connaissait l’endroit avec précision, car le matin du 23 un tronçon de barbelés avait été arraché, et une double procession de misérables entrait et sortait par cette brèche.
Nous nous mîmes donc en route, Charles et moi, dans le vent de la plaine livide. Nous dépassâmes la barrière abattue.
— Dis donc. Primo, on est dehors !
Eh bien oui ! pour la première fois depuis le jour de mon arrestation, je me trouvais libre, sans gardiens armés, sans barbelés entre ma maison et moi.
Les pommes de terre étaient là, à quatre cents mètres du camp peut-être : un trésor. Deux très longues fosses, pleines de pommes de terre recouvertes de couches alternées de terre et de paille pour les protéger du gel. Personne ne mourrait plus de faim.
Mais ce fut un rude labeur que leur extraction. Le gel avait rendu la surface du sol dure comme du marbre. En
donnant de grands coups de pioche, on arrivait à entamer la croûte et à mettre à nu la réserve […].
Autour de nous, tout n’était que mort et destruction.
24 janvier. La liberté. La brèche dans les barbelés nous en donnait l’image concrète. A bien y réfléchir, cela voulait dire plus d’Allemands, plus de sélections, plus de travail, ni de coups, ni d’appels, et peut-être, après, le retour. Mais il fallait faire un effort pour s’en convaincre, et personne n’avait le temps de se réjouir à cette idée. Autour de nous, tout n’était que mort et destruction.
Face à notre fenêtre, les cadavres s’amoncelaient désormais au-dessus de la fosse. En dépit des pommes de terre, nous étions tous dans un état d’extrême faiblesse : dans le camp, aucun malade ne guérissait, et plus d’un au contraire attrapait une pneumonie ou la diarrhée ; ceux qui n’étaient pas en état de bouger, ou qui n’en avaient pas l’énergie, restaient étendus sur leurs couchettes, engourdis et rigides de froid, et quand ils mouraient, personne ne s’en apercevait. […]
27 janvier. […] Les Russes arrivèrent alors que Charles et moi étions en train de transporter [le cadavre de notre camarade] Somogyi à quelque distance de là. Il était très léger. Nous renversâmes le brancard sur la neige grise.
Primo Levi, Si c’est un homme,
Charles ôta son calot. Je regrettai de ne pas en avoir un.
Julliard, 1987
Les intertitres ont été ajoutés.
L’arrivée de l’Armée Rouge


au moment de la Libération du camp.
Les officiers soviétiques découvrent le camp
Le général russe Petrenko, arriva à Auschwitz le 29 janvier 1945, trois jours après la libération du camp :
Le jour de mon arrivée à Auschwitz, on avait compté sept mille cinq cents rescapés.
Je n’ai pas vu de gens « normaux ». Les Allemands avaient laissé les impotents. Les autres, tous ceux qui pouvaient marcher, avaient été emmenés le 18 janvier. Ils avaient laissé les malades, les affaiblis ; on nous a dit qu’il y en avait plus de dix mille. Ceux qui pouvaient encore marcher, peu nombreux, se sont enfuis alors que notre armée s’approchait du camp.

Nous avons envoyé les unités sanitaires des 108e, 322e et 107e divisions sur le territoire du camp, les médecins de ces trois divisions ont mis en place des lieux pour se laver : tels étaient les ordres de l’armée.

Ces mêmes divisions ont organisé l’approvisionnement. On a envoyé des cuisines mobiles. Le deuxième jour, un régiment de réserve de l’armée est arrivé et a libéré nos soldats. […]
On m’a montré les pièces où l’on asphyxiait au gaz avant le crématoire. Le crématoire lui-même et une chambre à gaz avaient été dynamités.

J’ai vu aussi des enfants… C’était un tableau terrible : ils avaient le ventre gonflé par la faim, les yeux vagues, des jambes très maigres, des bras comme des cordes, et tout le reste ne me semblait pas humain, comme si c’était cousu. Les gamins se taisaient et ne montraient que les numéros qu’on leur avait tatoués sur le bras.

(Lire un commentaire de Serge Smulevic sur cette photo)
Ces gens n’avaient pas de larmes. J’ai vu comment ils essayaient de s’essuyer les yeux, mais ils restaient secs.
Général Petrenko, Avant et après Auschwitz , Flammarion, 2002
Des survivants très affaiblis
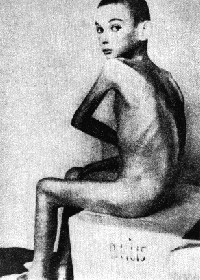
A peine 2000 des 7500 survivants du camp devaient vivre plus de quelques jours.


Photographie, 1945, Museum d’Auschwitz-Birkenau, Neg.-Nr. 766
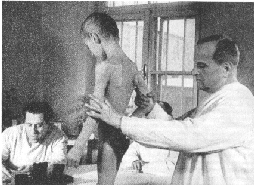
Les cadavres
Les cadavres engorgent les allées d’Auschwitz. Le typhus se répand dans le camp. Les Soviétiques doivent ensevelir rapidement les corps dans des fosses communes.

Autres découvertes
A la libération, les Soviétiques découvrent des piles de vêtements, de chaussures, lunettes, prothèses, des piles de bagages éventrés, de blaireaux, de peignes, de casseroles, et même des piles de cheveux, de dents en or…

Ils trouvent aussi la trace des expérimentations folles des « médecins » nazis. Ainsi, ils libèrent 90 jumeaux.

